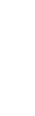
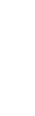

Planet-Vie
L’image du mois : des battements de cils dans le cerveau
Dans le cerveau, le liquide cérébro-spinal est produit par les plexus choroïdes et mis en mouvement grâce au battement coordonné des cils des cellules multiciliées.
Domestication des plantes et diversité des espèces cultivées
Les plantes domestiquées forment la base de l’alimentation humaine. La manière de domestiquer les plantes a évolué au cours du temps, allant d’une sélection massale empirique depuis le Néolithique aux outils d’édition génomique actuels.
La molécule du mois : les agonistes du récepteur du GLP-1
Des médicaments populaires et efficaces pour le traitement de l’obésité et des diabètes.
L’image du mois : des enfants envahissants chez Caenorhabditis elegans
Caenorhabditis elegans est un animal modèle de laboratoire ayant permis de nombreuses découvertes fondamentales en biologie. Le variant génétique présenté ici pond ses œufs avec un retard marqué : il retient ses embryons de manière inhabituelle, si bien que les larves peuvent éclore à l’intérieur du corps de la mère et devenir envahissantes, finissant par causer sa mort.
L’adaptation des populations humaines à leur environnement
Les êtres humains présentent des phénotypes variés qui se répartissent de manière hétérogène selon les zones géographiques. Ceci est le résultat d’une longue histoire évolutive qui a démarré dès l’émergence d’Homo sapiens il y a 300 000 ans, et qui s’est poursuivie avec le peuplement progressif des continents. L’accès de plus en plus précis au génome des populations humaines actuelles et anciennes permet aujourd’hui de reconstituer cette histoire.
La molécule du mois : les incrétines
GLP-1 et GIP sont des hormones qui sont libérées peu après un repas.
Les relations interspécifiques
Les différentes espèces qui peuplent la planète ne vivent pas isolées, mais sont au contraire liées par des réseaux d'interactions complexes. Ces interactions, de différentes natures, structurent les réseaux trophiques, permettent la reproduction de nombreuses espèces et ont ainsi de nombreuses conséquences écologiques et évolutives.
Le prix Nobel de physiologie ou médecine 2025 récompense des travaux sur la tolérance immunitaire périphérique
L’assemblée Nobel a décerné son prix de physiologie ou médecine 2025 à deux chercheurs américains, Mary Brunkow et Fred Ramsdell, ainsi qu’à un chercheur japonais, Shimon Sakaguchi, « pour leurs découvertes à propos de la tolérance immunitaire périphérique », en particulier concernant le rôle des lymphocytes T régulateurs (Trég).
Le diabète de type 1
Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, d’origine multifactorielle, qui se caractérise par une hyperglycémie chronique liée à la destruction des cellules β des îlots de Langerhans du pancréas par des lymphocytes T cytotoxiques auto-immuns. Le traitement de référence consiste en une administration d’insuline exogène pour restaurer l’équilibre glycémique. En parallèle, différents types de thérapies ont été développées ces dernières années : moléculaires, cellulaires, pancréas artificiels…
La molécule du mois : le récepteur de l’acide abscissique
La régulation de la tolérance à la sécheresse chez les plantes.
VIH et sida
Le sida est le stade le plus avancé de la maladie causée par le VIH. Ce virus affaiblit lentement le système immunitaire en parasitant et détruisant l’ensemble des lymphocytes T CD4+ de l’organisme. Sans traitement, les personnes infectées se retrouvent peu à peu sans défenses immunitaires et sont alors plus susceptibles de contracter des maladies dites opportunistes, aboutissant à la mort de l’individu. Si la trithérapie permet aujourd’hui de vivre avec le VIH, la recherche se poursuit dans l’espoir de mettre un jour un terme à cette épidémie.
La molécule du mois : la protéine Arc
Un lien inattendu entre les virus et le cerveau.







