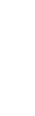
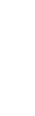

La vie des centrales françaises au-delà de 40 ans
publié le 08 Mar 2016 par Thomas BRIERE
Le parc électronucléaire français se trouve face à un immense défi : prolonger sa durée de vie au-delà des 40 ans atteints. En effet, la majorité des centrales d'EDF (comme les installations de recherche du CEA et celles d'AREVA) a été mise en service sur une période relativement courte, entre la fin des années 70 et celle des années 80. Si le nouveau PDG d'EDF, Jean-Bernard LÉVY, s'est dit « confiant » sur l'obtention du droit de prolonger la durée de vie de ses centrales « jusqu'à 50 ans, voire 60 ans » (1), pour Pierre-Franck CHEVET, président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), « cet allongement est un enjeu de sûreté considérable ». Le 20 janvier 2015(2) il a tenu à rappeler les principes que les opérateurs français devront suivre pour demander la prolongation du fonctionnement de leurs installations. Car, pour le moment, ces demandes n'en sont qu'au stade de l'étude.
Relever le niveau des exigences de sûreté
Les arrêts des réacteurs pour leur 4ème visite décennale seront l'occasion de vérifier qu'ils ne présentent pas d'anomalies remettant en cause leur sûreté, mais aussi de réaliser des travaux en vue de l'améliorer. « Notre demande, partagée par les autres Européens, est d'atteindre les référentiels les plus modernes. Pour les nouveaux réacteurs, ce sont les exigences applicables à l'EPR qui seront réclamées », a précisé Pierre-Franck Chevet. Pour les réacteurs existants, il faudra s'approcher autant que « raisonnablement » possible des référentiels de sûreté de la 3ème génération.
Au cours d'un séminaire technique réunissant l'ASN et EDF, qui s'est tenu durant l'été 2014, plusieurs sujets ont déjà été débattus. Par exemple, l'EPR est équipé d'un « cendrier » capable de recueillir le cœur en fusion en cas d'accident, afin de l'empêcher de traverser le radier (dalle constituant la fondation de l'ouvrage). Peut-on construire ce type de dispositif sous un réacteur existant ? Et si tel n'est pas le cas, quel système alternatif peut-on mettre en œuvre pour aboutir au même résultat ?
Autre point important : le dispositif de refroidissement de l'enceinte de confinement en béton. Pour le président de l'ASN, « nous sommes au début des discussions techniques ». Dans un premier avis, l'Autorité de sûreté doit en effet préciser, d'ici à la fin de l'année, l'ensemble des sujets et justificatifs de sûreté que les exploitants devront fournir. On devrait ensuite connaître, en 2018, sa position générique relative à la prolongation de la durée de vie des réacteurs de 900 mégawatts. À partir de 2020, l'Autorité prendra alors position réacteur par réacteur. Rappelons que 26 des 58 réacteurs qui constituent le parc français doivent passer leur 4ème visite décennale entre 2019 et 2025 : « La poursuite du fonctionnement des centrales nucléaires au-delà de quarante ans n'est donc pour le moment nullement acquise », a rappelé Pierre-Franck CHEVET. Pour mémoire, l'ASN a refusé de prolonger le réacteur de recherche Osiris du CEA car aucune solution n'a été trouvée pour renforcer sa sûreté. Cette 4ème visite décennale, ainsi que les nouvelles exigences liées à la catastrophe de Fukushima(3) vont mettre les effectifs de l l'ASN à rude épreuve. Ces derniers vont devoir faire face, dans un laps de temps relativement court, un volume de dossiers sans commune mesure avec celui qu'ils traitent habituellement.
Renforcer la transparence
« Le calendrier est serré, très serré », s'est inquiété Pierre-Franck CHEVET, qui précise que « l'ASN prendra le temps qu'il faudra », proposant de hiérarchiser les dossiers. Il insiste par exemple sur le fait que les centrales n'ayant pas encore démarré ne posent pas de problème de sûreté. Leur cas sera donc traité en deuxième ou troisième rang. La centrale de Flamanville, qui attend l'imprimatur de l'Autorité de sûreté nucléaire pour pouvoir démarrer, est clairement visée par Pierre-Franck CHEVET.
Selon lui, l'ASN et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui emploient 500 salariés chacun, ont globalement besoin d'un renfort de 2oo personnes pour mener correctement à bien leur mission. Or, le gouvernement n'a accordé que 30 embauches à l'ASN, étalée sur trois ans. Pour contourner les contraintes budgétaires, l'Autorité de sûreté propose de changer son mode de financement. Au lieu de percevoir l'argent de l'État (environ 300 millions d'euros par an), son président suggère la création d'une taxe payée par les acteurs de la filière nucléaire et directement affectée à l'ASN, sous le contrôle du Parlement. Un rapport sur le sujet est prévu dans la loi de Finances 2015. Avec pour objectif de collecter les 50 millions d'euros supplémentaires nécessaires à son bon fonctionnement.
La poursuite de l’exploitation des centrales n'est pas le seul sujet de préoccupation qu'a évoqué le président de l'ASN dans son bilan de 2014. Il a rappelé que, dans le projet de loi sur la transition énergétique, le cadre législatif sur la sûreté et la radioprotection allait également évoluer, en particulier pour ce qui concerne la transparence des activités nucléaires civiles. La participation publique, par exemple, est appelée à être renforcée.
Concernant la prolongation du fonctionnement des réacteurs, la consultation des citoyens, qui est actuellement fixée à trois semaines via Internet, va être transformée en consultation publique. Par ailleurs, les membres étrangers des pays limitrophes, qui étaient jusqu'ici de simples observateurs dans les commissions locales d'information, pourront dorénavant y siéger de plein droit.
Le cadre législatif a également introduit l'idée du « démantèlement immédiat », qui doit être préparé dans les deux ans suivant l'arrêt définitif d'une centrale. En effet, pour le législateur, ce sont les équipes qui ont construit et exploité l'installation qui sont les mieux indiquées pour mener à bien les plans de son démantèlement, avant que les personnels ne quittent l'entreprise ou ne soient mutés sur un autre site.
Article publié dans Arts & Métiers Mag n°370, février 2015 par Djamel KHAMES
(1) Source Challenges.fr, 20 janvier 2015
(2) A l'occasion des vœux de son organisation à la presse.
(3) Après l’accident de Fukushima, l’ASN a imposé des mesures de renforcement de la sûreté. L'une des règles les plus emblématiques est le relèvement du niveau sismique auquel les installations nucléaires devront résister. De plus amples précisions seront publiées dans le rapport annuel 2015. Il sera présenté en avril prochain devant l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.










